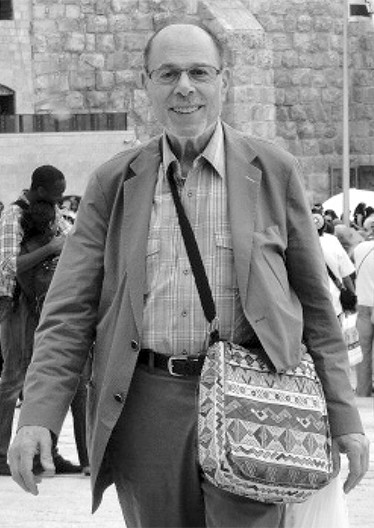
mon Rennes, marraine
Je ne sais toujours pas si mon Rennes m’a pris dans ses bras, si cette ville est marraine. Au bout de quarante-cinq ans de résidence ininterrompue dans la cité que mon travail me destinait et avait choisie pour moi. Dans mes rêves – est-ce la force de l’image primordiale? – si je déambule en Rennes, c’est Alger que je nomme sur l’écran de mon inconscience. Les images se superposent et se confondent. On naît dans une ville, on n’est que de cette ville. Et donc pour moi c’est toujours dans Alger que je vis, sauf que… sauf que cette ville-là s’appelle désormais Rennes. Une ville qui s’est bâtie de visages et d’images. À l’autre, les fantasmes, les mirages...
Il y a entre Rennes et moi une filiation étonnante, car mon père m’y précéda et y vécut quelques années, à peine douloureuses, et sûrement gratifiantes, car c’est à Rennes que sa vie précaire de blessé de Grande Guerre fut préservée et définitivement affermie. 1915 nous le montre, barbu et amaigri, dans une chambre de l’hôpital militaire Ambroise Paré – aujourd’hui transformé en immeuble de grand standing aux entrées jalousement verrouillées.
De retour de la guerre, il épousa maman, et plus tard, se rendant en Métropole comme tout bon fonctionnaire tous les deux ans, il ne manquait jamais de revoir sa Bretagne, et ces lieux chers à sa mémoire et sa survie: Saint- Malo, Quimper et Rennes, surtout, où l’on sait qu’il logea dans un de ces établissements scolaires transformés en Hôpital Militaire de Campagne (appellation contrôlée), à deux pas de la Vilaine, me disait-il, et c’était bien alors le collège Saint-Vincent, rue de Paris.
Arrivé à la fac de lettres en 1966
Voilà la raison profonde qui me poussa à accepter ce poste de maître-assistant à la Faculté des Lettres de Rennes en 1966, au sortir de trois années d’assistanat à la Sorbonne. En filiation et en fidélité. Et papa fut ravi de me rendre épisodiquement visite, avec maman, et je les amenais toujours dans quelque crêperie, rue du Chapitre ou rue Saint-Melaine où il viderait une ou deux bolées de cidre en essuyant la mousse autour de ses lèvres. Et nous ne manquions pas de traverser le jardin du Thabor, dont un vieux cliché montre qu’il aimait, en 1915, s’asseoir sur quelque rocaille du vieux parc. Ou de déambuler sur cette place de la Mairie, dont il évoquait le merveilleux emboîtement de la courbe saillante de l’Opéra avec l’entrée concave de l’Hôtel de Ville. Et puis il me montrait les rails résiduels en se rappelant quelque pique-nique d’autrefois à Cesson, terminus de l’ancien tramway.
Les années se sont écoulées. J’étais devenu professeur, j’avais des centaines d’étudiants, et maintenant que je suis en retraite il m’en reste des milliers dont beaucoup me sont attachés. Ce sont eux qui constituent les liens les plus forts qui me lient à cette ville. Et lorsqu’on me demande: mais enfin Alger, pourquoi ne pas y retourner? je réponds toujours que ce qui a disparu – définitivement – de ma ville natale, c’est sa géographie humaine. Ce sont tous ces visages qui ne sont plus et que je ne caresse, désormais, que dans ma tête. J’y suis, certes, retourné une fois, pour voir et revoir, vingt ans après l’Indépendance, mais j’avais beau parcourir toutes les rues de cette ville, que je possédais à fond, aucune tête ne me retenait, aucun bras pour m’arrêter, et nul ne me faisait signe: j’étais un étranger pour les gens du pays et la ville m’était devenue orpheline.
Ma seule cité mémorable
À rebours, Rennes est mon lieu de vie où tant de regards croisent le mien, où tant de bras se tendent, tant de mains se pressent et me serrent. Sans compter qu’à faire le décompte des années vécues là-bas et celles où je suis ici, forcément Rennes est devenue ma vraie ville, ma seule cité mémorable – et l’autre, immémorieuse.
Le 15 septembre 1966, j’étais venu – revenu (sauf que la dernière fois, j’étais encore au sein de ma mère) – avec Mathilde, ma belle épousée, reconnaître les lieux de mon destin. Mi destino, disais-je à ma femme, qui avait fui l’Espagne franquiste et cherchait, tout comme moi – « rapatrié » d’Algérie – un lieu de vie où jeter l’ancre. En espagnol, destino a le double sens de « destin » et de « destination », en fait le mot peut signifier tout bonnement le poste qu’on va occuper. Or mon mandarin de la Sorbonne dont j’étais l’assistant m’avait « destiné » Rennes, et papa avait béni ce destin-là, peut-être programmé dans son inconscient. Par une belle après-midi ensoleillée, tandis que l’épouse à l’hôtel Angelina restait à digérer le somptueux plateau de fruits de mer dont l’« Angélus » nous avait régalés (hôtel et restaurant nous faisaient angéliques), je remontais les rues d’un pas presque léger, au petit bonheur la chance, et cherchant vaguement à gagner le bâtiment où j’allais enseigner – cette Université de Rennes située alors place Hoche.
Les Nourritures Terrestres
Et voilà que je me suis trouvé longeant une rue où tout aussitôt cette librairie a accroché mon regard. « Les Nourritures Terrestres », quelle belle devanture pour moi qui revoyais – sans l’avoir vraiment vu – André Gide, réfugié à Alger dans les années quarante et logeant tout en haut de la rue Michelet, chez les parents de Marie Cardinal (pieuse et amicale pensée pour celle qui n’est plus) ! Et là, dans la vitrine, étonnement suprême, mon premier texte, ce récit des Bagnoulis, qui venait de paraître au Mercure de France et retraçait mon expérience du Djebel. Yvette et Jeanne Denieul, les deux « nourrices », et la silhouette tutélaire d’Yves Bertho, inoubliable trio, à ce point pénétré de littérature que les livres se déroulaient de leurs lèvres comme les bandelettes de papier dans ce film de Cocteau. Oui, Yvette était bien la Minerve du Testament d’Orphée crachant ses mots et révélant la Cité des Lettres. Je n’ai jamais cessé d’habiter cet entassement de livres, de nourrir de leurs noms les antres et les bois (comme dit Du Bellay).
Le repas avec Kundera
Dix ans plus tard, un fameux repas nous réunit chez eux, contour Saint-Aubin, avec Milan Kundera et Vera. Et voilà qu’Yvette avait brandi un immense gâteau où le chocolatier avait tracé, comme un emblème, comme une enseigne, « Vive la littérature! » - sauf que les lettres étaient en tchèque: Slovesnost. Et le regard de granit du géant de Brno – ville jumelle de Rennes - se couvrit comme d’un voile. Si subtile, Yvette, si délicate, et comme nous l’aimions! Lorsqu’on célébra les vingt-cinq ans de la création de l’Université de Haute Bretagne, en 1994, un hommage lui – ou leur – fut préparé, dont j’avais en charge le discours. Mais Yvette m’appela au petit matin: « Pourquoi me tirer de ma retraite ? Avec maintenant tout le poids des années! » Pourtant, à l’image de la ville, Yvette fut ma marraine. Et je ne l’oublierai jamais.
Que dire d’autre, Rennes, ville de mon parcours, collée à mes semelles bien plus durablement que le sable de l’autre rive et des ans envolés ?








