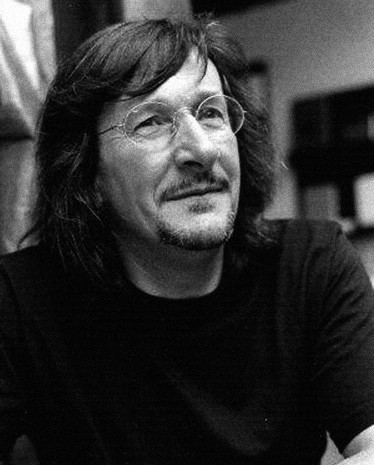
mes zones sensibles
S’il me fallait choisir un lieu – afin de dénouer quelques-uns des fils, presque invisibles, qui me relient à la ville – je me rendrais sans détour au rond-point du cimetière de l’Est. Je laisserais derrière moi le marbre, les fleurs, le café jaune très animé (on y déguste huîtres, muscadet, galettes-saucisses, Grimbergen et autres délices tous les dimanches avant ou après la visite aux morts). Je laisserais, de même, l’écrivain Henri Thomas, l’auteur de La Nuit de Londres et du Promontoire, dormir en paix derrière les murs de schiste rouge et remonterais au ralenti la rue Auguste Pavie. Celle-ci mène droit à la zone industrielle mais avant d’y parvenir il n’est pas inutile de s’arrêter un instant en haut d’un frêle monticule, qui ne paie pas de mine, qu’on hésite à appeler pont, ce qu’il est pourtant, et qui surplombe une petite voie de chemin de fer.
Un no man’s land ferroviaire
Le vent s’y promène à son aise. L’hiver, le givre se colle au bitume. L’été, c’est le soleil qui le tanne, le faisant fondre assez souvent. L’endroit est à découvert. Celui qui s’y attarde et qui regarde l’enchevêtrement des rails et des lumières qui, partant d’ici, s’étendent à main droite, sur un pan entier de la ville, y découvrira un paysage bosselé et incertain, une sorte de no man’s land où se mêlent en heureux désordre arbustes, bouts de routes, hangars, immeubles, maisons basses, début de plaine…
Je fus, un temps, celui qui s’attardait là. Je n’y restais pas plus de deux ou trois minutes, à chaque fois au point de l’aube, avant de poursuivre ma route, de passer devant le vieux bâtiment que les cheminots nomment La Feuille et de prendre la rue des Veyettes où je devais, comme les autres, comme les vingt-neuf mille salariés de la zone, m’en aller pointer.
La première fois que je fis ce parcours, ce fut à bord d’une voiture postale. Celle-ci me largua sur un parking. Puis le chauffeur me salua, fit un rapide demi-tour et démarra sur les chapeaux de roues, me laissant seul devant la porte métallique d’un hangar. Un grand type, alerté par le crissement des pneus, vint à ma rencontre. Il me dévisagea, m’écrasa les phalanges et m’invita à le suivre. Les salutations furent courtes. Celui qui m’avait accueilli – ou plutôt cueilli – dès mon arrivée était Le chef.
« Ici, on n’aime pas les fainéants », dit-il en me toisant de bas en haut.
Je ne répondis pas mais compris tout de suite que ce type allait me donner du fil à retordre.
Le lendemain, il vint avec un chronomètre à la main, se planta derrière moi et, sans un mot, se mit à évaluer mes cadences. Son petit manège dura près d’un mois. Puis il s’émoussa et finit par partir en vrille à la lecture d’un premier tract où ses excès de zèle étaient vivement dénoncés. Je savais, et ce dès le premier jour, que dans sa tête le mot « fainéant » équivalait à peu près à celui de « militant syndical » et que c’était donc sur ce terrain, où une petite réputation m’avait précédée, qu’il fallait se positionner. Dès qu’il remisa son chrono au placard, je pus me libérer l’esprit et arpenter enfin Rennes avec des idées de flâneries en tête.
La travée pavée de Saint-Melaine
L’image chiffonnée du Chef ne mit pas longtemps à se déchirer puis à s’émietter jusqu’à disparaître totalement entre les pavés de la rue Hoche. D’un trottoir à l’autre, làbas, les gens marchaient à vive allure. La pluie et la fin du jour leur dictaient de rejoindre leurs pénates sans attendre.
Ce monde en mouvement, légèrement décalé, pris entre les lumières multicolores des vitrines et celles, jaunes, rasantes, projetées par les phares des voitures sur le revêtement mouillé, me mettait de bonne humeur. Ma promenade me menait vers une librairie. Qui n’existe plus désormais mais qui, à l’époque, constituait le coeur littéraire de la ville. Deux dames vives y officiaient en compagnie d’un homme strict et de nombreux portraits, qu’on aurait pu penser de famille, d’écrivains célèbres et morts. En chemin, je m’étais arrêté, un instant plus tôt, en ce crépuscule humide d’automne 1980, l’oeil rivé sur une perspective qui allait, elle aussi, tout comme celle du pont de l’Est, s’ancrer à demeure dans ma mémoire. L’endroit, situé en haut de la rue Saint-Melaine, offre une vue instable, étroite, bombée, cabossée, sur une travée pavée qui va, en pente douce et en ligne droite, se perdre jusqu’aux abords de la place Sainte-Anne. Posté là, regardant cette rue étroite, j’avais l’impression, je l’ai toujours, que s’y trouve peut-être l’une des portions de Rennes qui a le moins bougé depuis deux ou trois siècles.
Peu après, puis au fil du temps, d’autres lieux – ainsi la place de Zagreb, son plateau marchand, très animé et, par bonheur, cosmopolite du samedi matin, ainsi l’immeuble paquebot qui, poupe au vent, peut me transporter en un clin d’oeil de la rue de Verdun à Saint-Nazaire – vinrent s’ajouter à cette bizarre géographie infime et citadine que je ne cesse d’alimenter. Cela n’exclut pas les désenchantements et les rêves qui vont avec. Si, par malchance ou malveillance, une perspective bute sur un obstacle, mon imaginaire se met immédiatement en branle, parvenant même à penser l’impensable, à savoir, par exemple, qu’un jour forcément lointain, cette ville qui bouge, qui remue tant et tant en dedans et en sous-sol, réussira bien, à force de contorsions, à envoyer valdinguer par-dessus bord ces tonnes de béton et ces dizaines de barres métalliques que certains, en d’autres temps, ont assemblé pour cacher le cours paisible de sa rivière à l’endroit même où on aimerait tellement la voir couler.








