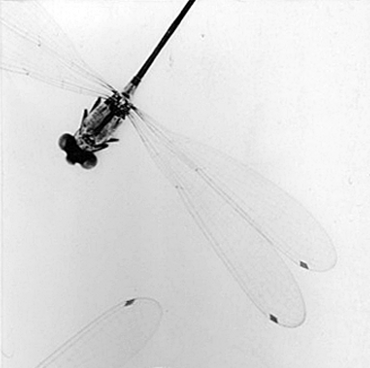
au fil des rues, au fil
des mots
Didier Desbrugères (suite)
Né en 1960, Didier Desbrugères a dû attendre l’âge de 50 ans pour voir l’un de ses manuscrits édité pour la première fois. C’est un homme discret habitant la métropole rennaise depuis 17 ans. Pour le reste, croyons-en la quatrième de couverture du Délégué qui indique : «Esprit éclectique, il s’est essayé à la peinture et à la sculpture sans jamais rompre avec la lecture ni avec l’écriture, pôles magnétiques de son existence. Il a tenu une galerie d’art tout en menant une carrière professionnelle dans l’aéronautique. »
Didier Desbrugères n’a pas dit son dernier mot. Encouragé par une entrée remarquée dans la littérature imprimée, il travaille à élargir encore notre horizon de lecteurs. Lecteurs forcément impatients de poursuivre avec lui ce beau chemin d’écriture.
Rennes a pris place dans ma vie en 1995. Auparavant, elle n’était pas même une étape sur le trajet estival entre mon Puy-de-Dôme natal et le village de Kerouac, en bordure du golfe du Morbihan. La DS 21 paternelle filait au plus court, changeait de cap à Nantes. Les grèves entre océan et ajoncs se sont installées à demeure dans ma mémoire. Aussi, venue l’heure de déserter le Paris de mes débuts, c’est tout naturellement que mes regards se sont dirigés vers la Bretagne. Les opportunités professionnelles ont fait le reste.
Une vue plongeante sur les Lices
Depuis mon appartement, je jouissais d’une vue plongeante sur la place de Lices et les toits d’ardoise que les lueurs vespérales transformaient en chaos cubiste. Le samedi est jour de marché, qui abandonne sur le pavé : fanes, papiers et fruits gâtés dans les caniveaux. Les emballages isothermes en polystyrène s’éventrent avec un craquement bref sous la semelle. Champ de bataille que des territoriaux en salopettes chamarrées de pièces fluorescentes s’emploient à toiletter.
L'amateur d'histoire locale apprend que Martenot, architecte en titre de la ville à cette époque, a achevé la halle éponyme en 1869. Moulée dans la masse, une inscription l’instruit de la provenance des piliers de fonte : Lemoine, constructeur, Fonderie Guy, Rennes. De l’autre côté de la rue s’échelonnent d’imposants hôtels particuliers qui, dit-on, doivent leurs toitures en carène renversée et leurs escaliers monumentaux à des charpentiers de marine. Des marginaux et leurs meutes tuent le temps sur les perrons de granit. Bâtisses et désoeuvrés en rupture de ban m’ont inspiré une nouvelle, toujours dans mes cartons, qui trouvera à s’imprimer, ou pas.
Les Nourritures Terrestres…
Pour rejoindre la place Sainte-Anne, la rue Saint-Louis, où gîte une librairie, propose une alternative bienvenue à la remontée de la rue Saint-Michel aux airs de souillon et au pavé graisseux. Avec sa nef tronquée, colmatée par une façade nue crevée d’un portillon lilliputien, la basilique Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle fait triste mine. À deux pas, c’est la rue Hoche. Les jeunes gens, qui se pressent devant la sandwicherie bellement baptisée Les Nourritures Terrestres, savent-ils qu’il n’y a pas si longtemps nichait dans ces murs une librairie à laquelle ce même nom seyait à merveille. Lieu de rendez-vous avec la littérature, cabinet propice aux tête-à-tête avec les livres. Comme si l’acte de lire - pendant gémellaire de celui d’écrire – apparaissait, à un certain niveau d’exigence, si intime que le moment du choix se devait de revêtir la forme d’un prélude à la solitude enchantée du lecteur. Choisir un livre, c’est déjà l’accueillir ; c’est un acte de gourmet.
Parfois point de provende, l’ouvrage convoité fait défaut. La maîtresse de céans, petite dame énergique à la taille proportionnée à l’exigüité des lieux, est désolée. Sonné, le client préparé au bonheur d’une rencontre met un moment à rassembler ses esprits, manquant de justesse de s’affaler dans le fauteuil au cuir noir râpé qui, dans son dos, semble prêt à le recevoir.
L’antre du bouquiniste
En guise de consolation, cent mètres en aval, s’offre l’antre d’un bouquiniste coiffé d’un béret de laine multicolore. Un couple de pièces sombres bardées de rayonnages bourrés à bloc, des piles branlantes de livres défraîchis, écornés, riches de vie multiples (magnifique prétexte à nouvelle ; inévitable, elle attend son heure avec les marginaux enrôlés). De cette caverne d’Ali Baba nul moyen de s’échapper autrement que nanti d’un roman oublié de Gabriel Chevalier ou d’un traité de chirurgie militaire obsolète.
Rue Victor-Hugo, plus prestigieux, avait élu domicile un marchand de livres anciens, également disparu avec ses trésors et son savoir. Dans la vitrine, je me souviens, languissait un ouvrage insolite. La couverture d'un bleu éteint - celui qu'on imagine aux capotes fatiguées des fantassins de 1916, après Verdun et la Somme - protégée par une enveloppe de papier cristal. Ambroise Tardieu, professeur de médecine légale à la faculté de médecine de Paris en est l'auteur. L'édition date de 1879. On la doit à la librairie J-B. Baillière et fils, rue Hautefeuille, près du bd Saint-Germain. Illustrations à l’appui, la monographie atteste que parfois la détermination des prisonniers n’a d’égal que leur désespoir. «C'était un médecin légiste réputé au dix-neuvième siècle.» Délivrés d'une voix dénuée de pédanterie, le bouquiniste s'en tient là des détails biographiques. Il replonge dans ses papiers, ayant dit ce qu'il fallait, ni trop ni trop peu pour appâter le client. Amorcer la curiosité du bibliophile. Le livre vaut 700 francs (je parle d’une époque où le Parlement distant d’un jet de pierre portait encore les stigmates des flammes). Le chiffre est inscrit au crayon en haut à gauche de la page de garde. C'est une somme. Non sans regret, on se replie les mains vides, peiné, en contournant le pâté de maisons.
Les enveloppes en papier kraft
À condition de maintenir le regard à hauteur des étages, la venelle Saint-Georges remonte le temps. Un recueil collectif de nouvelles auquel je devais contribuer y fut le motif à d’honnêtes libations. Les Éditions Balle d’Argent ont disparu, le recueil n’a jamais vu le jour, L’appel dort toujours.
Un autre éditeur avait son adresse sur les quais. La façade cossue cache une cour intérieure digne d’un roman d’Eugène Sue. Murs de briques, pavés ronds, patibulaire escalier extérieur menaçant comme un coupegorge. La boîte aux lettres déborde d’enveloppes en papier kraft. Avant d’y glisser la mienne, je ne peux m’empêcher de jeter un oeil sur le dessus de la pile comme on lorgne son voisin sur la ligne de départ. Je ne sais pourquoi, le patronyme féminin m’évoque une jeune fille encore imprégnée de cette fascination adolescente pour les vies fulgurantes des écrivains maudits. Peut-être estelle à présent un auteur confirmé, qui sait désormais que seul le travail compte. Le Délégué n’obtiendra pas de réponse, il sera publié plus tard par Gaïa Éditions, éditeur landais qui le prendra sous son aile chalossaise.
Dans le Panthéon rennais
Sans tapage, le Panthéon rennais a trouvé asile dans les murs de la mairie. Ici, rien de clinquant. La fresque en toile marouflée forme une procession au-dessus des listes interminables de noms. Tons crayeux, pigments extraits de cette terre avec laquelle ils ont fait corps et qui en a tant gardé. Poilus enveloppés de peaux de mouton, chargés de bouteillons, de musettes, capotes élimées, qu’on devine monter en ligne, nullement héroïques, durs à la peine. Le pinceau de Camille Godet honore cette lutte collective et personnelle. Au plafond brillent les noms que l’Histoire a retenus, ceux des généraux, y compris les acharnés qui n’ont guère été économes de la vie des humbles. Pour moi à qui un demisiècle d’existence épargne d’arpenter longtemps la lignée des aïeux avant de tomber sur un de ces combattants, ce temps parle toujours ; pour mon fils, c’est déjà un autre siècle. Ce bout d’histoire m’habite. Il surgira encore sous ma plume ainsi qu’il l’a déjà fait. Vers ceux-là et leur terrible épopée, je sais que je reviendrai. Ils n’ont pas fini de m’interroger, pétris d’argile, avec leurs vies d’homme telles des trésors précaires.








