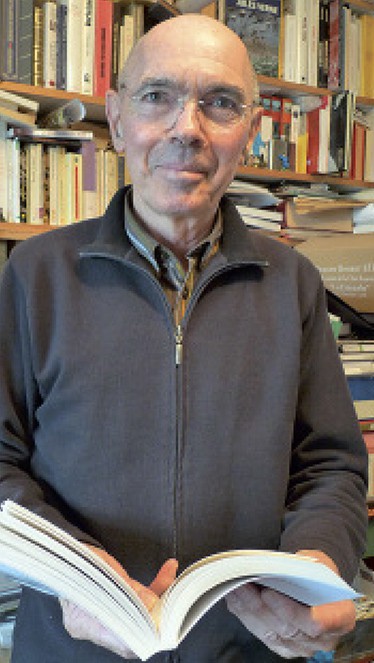
Place Publique> Quel est votre itinéraire personnel et professionnel ?
Bernard Le Doze > Je suis Finistérien, mais c’est à Vannes que j’ai passé mon enfance et mon adolescence. Mon père, militaire de carrière, était en poste. J’y ai donc fait mes études secondaires jusqu’au bac philo. Puis je suis allé en fac de lettres modernes à Rennes. On était en plein 68. Les études étaient très exaltantes et à la fois très perturbées.
PLACE PUBLIQUE > Les études de lettres à l’époque, c’était le règne de la théorie littéraire et du structuralisme. Pas très proche du Goncourt, tout cela!
BERNARD LE DOZE > C’est vrai. Mes études ont correspondu à une période de non-lectures littéraires. La théorie du texte primait, la littérature était niée dans sa vitalité et dans son aspect existentiel. Mais je ne le regrette pas, car nous avons ainsi reçu un apport conceptuel important. Et puis, la littérature a bénéficié de ce dépoussiérage.
PLACE PUBLIQUE > C’est donc avec ce bagage théorique que vous devenez enseignant ?
BERNARD LE DOZE > J’ai passé le Capes de lettres modernes et mon premier poste fut à Ernée en Mayenne. Ce fut la découverte soudaine du milieu rural, que je ne connaissais pas. Pour quelqu’un qui sort de la théorie littéraire, ce fut un vrai choc de découvrir le déficit culturel. Deux ans plus tard, j’ai été nommé à Romillé en Ille-et-Vilaine, toujours en milieu rural donc, et j’y suis resté pendant dix-sept ans. J’ai été passionné. J’aimais ces enfants dont les parents étaient agriculteurs, employés ou ouvriers chez Citroën. Ils avaient un grand besoin de culture, ce qui m’a amené à lancer des projets pour les inciter à la lecture. Ces projets ont fait que le rectorat m’a donné des décharges de cours. Le Goncourt est né à ce moment-là. Ce fut un tournant dans ma carrière.
PLACE PUBLIQUE > Cette possibilité de sortir de la classe est un cadeau, non?
BERNARD LE DOZE > Il ne faut pas oublier que tout cela se passe dans les années 80, celui de l’arrivée de la gauche au pouvoir avec des ministres comme Jack Lang. Il y a à l’époque une extraordinaire demande de projets à caractère culturel à l’école, notamment concernant la lecture où il y avait un gros déficit. Je pouvais multiplier les projets avec l’assurance d’être soutenu: faire venir des écrivains, lancer des ateliers d’écriture, tout cela attirait la lumière sur vous et vous ouvrait les portes à l’époque.
PLACE PUBLIQUE > C’est alors que l’aventure du Goncourt des lycéens se met en place?
BERNARD LE DOZE > Au départ, le Goncourt naît en dehors du cadre institutionnel. Il naît de la rencontre avec Brigitte Stéphan, qui était directrice de la communication à la Fnac. Nous nous sommes demandé ce que nous pourrions faire ensemble pour inciter les élèves à la lecture. Elle, elle avait les livres, moi, j’avais les enfants. Nous nous sommes dit : si nous leur faisions lire des livres qui ne sont pas dans le programme, des livres de la rentrée littéraire, des livres qui a priori ne s’adressent pas à eux. Et surtout des livres que les profs n’auront pas lus, qu’ils découvriront en même temps que leurs élèves.
PLACE PUBLIQUE > Au départ, une aventure strictement rennaise, donc?
BERNARD LE DOZE > Oui, la première année, en 1988, nous avions trouvé dix classes dans cinq lycées rennais, à raison de deux classes par lycée pour que les profs puissent travailler en tandem. Chaque classe avait un représentant, ce qui faisait au final un jury de 10 membres, à l’instar du jury de l’Académie Goncourt. C’était fait de bric et de broc. On ne savait pas trop où l’on allait.
PLACE PUBLIQUE > Et finalement vous reconduisez le test?
BERNARD LE DOZE > C’est Erik Orsenna qui a déclenché les choses. Cette année 1988, il a eu à la fois le Goncourt de l’Académie et celui des élèves. Avec son enthousiasme bien connu, il a voulu les rencontrer. On est donc allés déjeuner à La Chope avec lui. Il a posé mille questions aux élèves qui étaient ravis deparler avec leur lauréat. On s’est dit : là, il s’est passé quelque chose. Lui a insisté, cette opération de lecture des lycéens mérite d’être reconduite. Avec Brigitte, nous avons alors décidé de développer le prix, de ne plus nous cantonner à Rennes et de trouver dix lycées en Bretagne.
PLACE PUBLIQUE > Est-ce qu’à l’époque l’Éducation nationale soutient cette initiative?
BERNARD LE DOZE > À l’époque, c’était moi tout seul, horscadre, qui portait cela. Malgré tout, j’avais une petite légitimité: j’étais professeur-relais de lettres au Centre régional de documentation pédagogique. J’ai écrit à l’inspecteur d’académie et à mon inspecteur de lettres pour que l’Éducation nationale soutienne ce Goncourt : 25 ans après, j’attends toujours la réponse! Cela dit, mon directeur du CRDP, quelqu’un de très bien, m’a dit: « Je vous couvre, allez-y ». La deuxième année, le prix s’est donc fait avec 10 lycées bretons et la troisième année avec 10 lycées en France.
PLACE PUBLIQUE > Et toujours pas de feu vert des autorités?
BERNARD LE DOZE > Toujours pas. Mais en même temps, dès la deuxième année, l’avis des élèves était rendu devant la télévision dix minutes avant le « vrai » Goncourt. La Fnac avait fait un extraordinaire travail de communication. L’opération était connue, légitimée par tous. Mais en effet rien d’officiel au niveau de l’administration. Savezvous que la convention entre l’Éducation nationale et la Fnac n’a été signée que l’an dernier ! Pendant plus de vingt ans, le prix a fonctionné très bien, sans pépin, pour le plus grand plaisir de tous.
PLACE PUBLIQUE > Vous étiez quand même soutenus par la hiérarchie?
BERNARD LE DOZE > C’est vrai, dès la troisième année, nous avons été couverts par le recteur: le rectorat a vraiment été dans le coup et ce fut capital. Quant au corps d’inspection, il savait, il voyait les élèves lire et ne trouvait rien à objecter. Un autre soutien, et cette fois-ci de la première heure, ce fut la Ville de Rennes. Il fallait être comme Edmond Hervé un militant de la lecture au fond de son coeur pour accueillir dès la première année dix élèves dans le grand salon de la mairie, alors que nous formions un groupe presque clandestin.
PLACE PUBLIQUE > Comment cette démarche du Goncourt des lycéens était-elle perçue par les enseignants. Y avait-il des oppositions ?
BERNARD LE DOZE > Pas d’opposition. Pendant 13 ans, j’ai conduit cette affaire en étant continuellement au téléphone avec eux, dans tous les coins de France. Ils étaient très excités par cette opération. La difficulté pour eux, c’était l’après-Goncourt, c’était de revenir au programme scolaire.
PLACE PUBLIQUE > Et l’Académie Goncourt, de quel oeil voyait-elle cette expérience?
BERNARD LE DOZE > Au départ, on ne s’appelait pas « Goncourt ». Dès que l’on a pris l’appellation, François Nourissier qui était alors le président a donné son accord sans problème. Des poids lourds comme Michel Tournier nous soutenaient. Mais tout le monde n’approuvait pas si l’on en croit ce que disent ceux qui nous soutiennent comme Edmonde Charles-Roux ou Didier Decoin. Donc au départ, les Goncourt ont donné leur accord, mais sans regard précis sur ce que nous faisions. Nous puisions notre sélection de 10 titres dans la première sélection du Goncourt. Mais cette liste comportait une vingtaine de titres et fluctuait au fil des semaines. Si bien que l’on était jamais sûrs que notre lauréat appartienne à la dernière sélection. Ensuite, cela s’est simplifié sous l’égide d’Edmonde Charles-Roux qui a souhaité que la sélection du Goncourt des lycéens soit exactement la même que celle de l’Académie.
PLACE PUBLIQUE > En conséquence, vous n’êtes plus maître de cette sélection et certains titres peuvent poser problème?
BERNARD LE DOZE > C’est vrai, il y a eu l’épisode Michel Houellebecq avec ses sulfureuses Particules élémentaires, en 1998. Moi, je dis que l’on peut mettre tous les livres entre les mains des élèves, à condition qu’il y ait projet et accompagnement. Donner ce livre sans précaution, c’est risqué, mais dans le cadre du Goncourt, il n’y a pas grand risque. Houellebecq avait fait scandale dans la société civile avec ce livre, certains s’étaient indignés qu’il figurât parmi les livres proposés aux lycéens. Face à cela, le recteur d’académie avait dit : « on ne censure pas ». Mais, m’avait-il précisé: débrouillez-vous, faites en sorte que les élèves qui ont envie de le lire le lise et que ceux qui n’ont pas envie ne le lise pas.
PLACE PUBLIQUE > Et alors, comment s’est terminée cette affaire Houellebecq?
BERNARD LE DOZE > Eh bien, c’est ce que nous avons fait. Mettre un cordon sanitaire autour de cette lecture et laisser la liberté de lire ou non. Entre parenthèse, il n’y a rien de tel pour inciter à la lecture. Au bout du compte, les élèves étaient très fiers parce qu’on leur faisait confiance, on les prenait pour des adultes. Très peu ont été ceux qui ont refusé la lecture. Je me souviens d’un proviseur de Reims qui avait interdit le livre, il s’est fait chahuter. Je le redis, un livre peut être un choc, mais s’il y a des garde-fous et une liberté de dialogue, tout devient possible.
PLACE PUBLIQUE > Qu’est-ce qui explique d’après vous le succès du Goncourt des lycéens
BERNARD LE DOZE > Le partenariat avec la Fnac y est pour beaucoup. Ils ont été épatants. La rencontre entre une logique disons communicationnelle et une logique éducative a très bien fonctionné entre nous. Dès que nous avons eu un budget, nous avons eu l’idée de demander à deux sociologues d’aller enquêter dans les lycées auprès des enseignants et des élèves. Eh bien, le Goncourt fonctionne toujours sur ce travail : il s’agit de maintenir cette opération en dehors du cadre institutionnel en profitant au maximum du cadre institutionnel: lycée, enseignants, etc. Avec un objectif: obtenir des élèves qu’ils lisent. Nous étions dans une logique de médiation: aider, aider, aider. Qu’il y ait échange, qu’il y ait débat, que les élèves commencent à avoir une parole libre et différente, qu’ils aient un avis différent de l’Académie Goncourt. L’autogestion des jurés est une chose formidable: ils acquièrent une maturité énorme, c’est un apprentissage de la démocratie. Ils en sortent transformés.
PLACE PUBLIQUE > Un autre point important du succès concerne les rencontres avec des écrivains ?
BERNARD LE DOZE > C’est vrai. Quand, au bout de quatre ou cinq ans, on a vu que le prix était reconnu, j’ai demandé une enveloppe au ministère de la Culture pour faire venir des écrivains à Rennes. Nous voulions bâtir, après coup, un espace de rencontre entre les lycéens et les auteurs des romans qu’ils venaient de lire, qu’il y ait une phase d’échanges, un oeil sur les coulisses de la création. C’est ainsi qu’avec de nombreux partenaires (Ville, Drac, conseil régional) nous avons monté en 1992 les Rencontres nationales Goncourt des lycéens. Chaque début décembre, nous faisons venir à Rennes des centaines d’élèves pendant trois jours, logés à l’hôtel, pour rencontrer des écrivains, des éditeurs, des critiques. Au début, cela se passait à l’Opéra et au TNB, et désormais au Triangle.
PLACE PUBLIQUE > Vous, personnellement, quels moments forts, quelles rencontres marquantes retenez-vous de ces deux décennies ?
BERNARD LE DOZE > Il y en a eu tellement ! Je pense par exemple à Claude Pujade-Renaud, une des premières lauréates, avec Belle-mère : elle a été merveilleuse. Je pense aussi à Olivier Rolin qui a été important, à Jean-Claude Milovanoff. À Orsenna, bien sûr, qui venait chaque année… Je retiens aussi cette belle déclaration d’Edmonde Charles-Roux : « La plus belle réussite du Goncourt, c’est le Goncourt des lycéens ! » Je retiens aussi une foule de moments mémorables entre écrivains et élèves : cela ne tient pas uniquement à ce qui se dit, mais à ce qui se « passe » entre la scène et la salle. Certains écrivains ont ce sens du contact, cette présence, ce goût de répondre, d’expliquer, qui fait que pour les élèves il y a un « avant » et un « après ».
PLACE PUBLIQUE > Revenons à votre carrière. Avec le Goncourt, vous avez complètement quitté votre poste d’enseignant ?
BERNARD LE DOZE > Pas du tout. J’ai fonctionné longtemps avec des heures de décharges. J’ai intégré l’équipe d’action culturelle du rectorat en faisant notamment de la formation. Dans les années 90, je suis devenu coordonnateur académique du Clemi, le Centre de liaison de l’enseignement et des moyens d’information, dont le principe est de faire lire la presse. Ensuite j’ai été mis par l’Éducation nationale à la disposition du directeur des Affaires culturelles (Drac Bretagne) pour favoriser l’entrée des classes dans tout le milieu culturel. Une carrière ouverte et formidable. Au bout de six ans de Drac, je suis devenu conseiller du recteur pour l’éducation artistique et culturelle. Après, j’ai souhaité passer le relais…
PLACE PUBLIQUE > C’était l’heure de la retraite?
BERNARD LE DOZE > Pas seulement. On avait changé d’époque. J’avais vécu la montée en puissance des partenariats qui étaient au coeur de l’action des deux ministères de la Culture et de l’Éducation nationale. Depuis 2002, on assiste à une descente progressive. Il n’y a plus d’argent. Il n’y a plus d’enseignants avec des heures de décharge- poste. Je regrette cette période bénie qui pour toute une génération de profs et d’élèves a été une ouverture extraordinaire. Tout n’a pas été réussi, mais nous permettions à l’élève d’élargir son horizon.
PLACE PUBLIQUE > Au cours de toutes ces années, qu’avezvous appris sur l’acte de lecture et sur l’apprentissage de la littérature?
BERNARD LE DOZE > Qu’il ne faut pas brusquer les élèves. Le bourrage de crâne ne sert à rien. Il faut laisser l’enfant baigner dans sa maturation personnelle, tout en lui faisant miroiter autre chose. Quand on travaille sur le strict programme, l’élève sait que le prof est incollable. Il voit que les textes sont tenus à distance, qu’on ne recherche pas le plaisir. Ce qui fait la force du Goncourt c’est que, tout en étant dans l’espace scolaire, il ne permet pas au prof de donner son avis, d’imposer des exercices normés. Laisser l’élève discuter et se former une opinion personnelle, voilà la règle qu’il faut généraliser.
PLACE PUBLIQUE > Comment voyez-vous l’avenir du Goncourt des lycéens ?
BERNARD LE DOZE > On peut s’interroger sur la pérennité du prix. Que deviendra la Fnac? Ne va-t-elle pas un jour renoncer au livre papier, privilégier l’achat par Internet ou le livre numérique. Cela coûterait des sommes énormes de distribuer une tablette de lecture numérique à tous les élèves du Goncourt. Autre interrogation: j’observe un recentrement du prix vers le ministère de l’Éducation nationale. C’est très bien, mais je redoute que le Goncourt ne devienne l’affaire de la direction de l’enseignement scolaire, du corps de l’inspection, ce qui serait selon moi, un contresens absolu. En effet, le Goncourt réclame un soutien fort des chefs d’établissement et de quelques enseignants motivés. Mais il ne faut pas qu’il soit ceinturé par l’inspection. Il faut qu’il soit libre de toute entrave didactique. Son originalité profonde est d’être, au sein d’un lieu d’éducation bien cadré, un espace de liberté.
PLACE PUBLIQUE > Aujourd’hui, vous avez totalement quitté le navire Goncourt ?
BERNARD LE DOZE > Je reste membre de l’association « Bruit de Lire » que nous avions créée en 1991 pour recevoir des financements. C’est un lieu vivant qui réunit une vingtaine de responsables du Goncourt, avec notamment un référent par région. Désormais, à ma demande, je ne suis plus qu’un membre de base.








