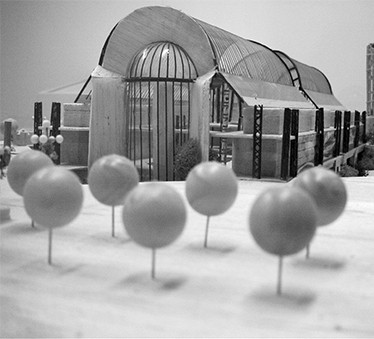
à l’Ouest ?
Deux clés de lecture apparaissent lorsque l’on aborde la toute fin de la décennie 1970 : on n’y aura probablement jamais autant parlé de démocratie locale et de proximité au moment même où la mondialisation s’annonçait – et la concurrence entre les métropoles régionales; les principales villes du Grand Ouest, Nantes, Rennes, Brest, La Roche-sur-Yon et Angers, « tombent » à gauche (qui remporte au total 55 grandes villes) au moment même où se précise la crise du marxisme, dont on oublie trop aujourd’hui qu’elle s’est produite au beau milieu de l’euphorie apparente du Programme commun et des progrès de l’Union de la gauche.
Bien difficile cependant de lire nettement un clivage droite / gauche dans les politiques d’urbanisme pratiquées depuis. Certes, il reste le logement social. Qu’il abrite les presque riches aussi souvent que les très pauvres, le logement social demeure l’instrument majeur d’une politique urbaine et l’ultime critère discriminant entre les deux camps. Mais pour le reste, dire qu’il existe une politique urbaine de gauche s’opposant à une politique de droite est risqué. On a bien essayé, dans l’euphorie de l’après-mai 81, de parler officiellement d’un urbanisme « de gauche » conjuguant démocratie locale, services et proximités. Tout en allant rechercher des modèles « de droite » à travers le projet de quartier, comme on l’a dénommé à l’époque. Par exemple celui que l’urbaniste Gaston Bardet avait formulé sous Vichy.
Dès lors, la simplification n’est jamais loin: Le Rheu, dans la banlieue rennaise, est-il de droite ou de gauche? Quant au spectaculaire, il est un versant emprunté aussi bien par les politiques « de gauche » comme « de droite ». Combien de collectivités, de gauche comme de droite, auront, ces dernières années, été en quête de leur « effet Bilbao »? Et Jean Bousquet, à Nîmes, était un maire UDF tandis que Georges Frêche, à Montpellier, sera resté au PS aussi longtemps qu’il aura pu, mais il est évident que les deux villes voisines auront, tout au long des années 1980, joué sur le spectaculaire à travers leurs politiques urbaines. Non, l’histoire que nous cherchons à restituer à grands traits, la vie urbaine des grandes villes de l’Ouest passées à gauche suite aux municipales de 77 est à chaque fois spécifique, parce que chaque ville a son histoire, ses enjeux… et son serpent de mer. Et en général, ça se passe au centre.
En 1977, Nantes n’est pas au mieux. La ville perd 16 000 habitants entre 1975 et 1982. Les autoroutes se sont donné rendez-vous au pied du Château des Ducs avant d’aller flâner du côté du quai de la Fosse où s’engouffre encore toute la circulation de l’estuaire. Et encore aura-t-on échappé de justesse au projet de voie express devant relier les rives de l’Erdre au centre-ville porté par la municipalité André Morice, ce radical pratiquant une large alliance de l’extrême droite aux socialistes… Sur les quais de l’Erdre dorment alors les voitures plutôt que les péniches. La place Royale est un rondpoint. La rue de Richebourg et l’île de Versailles n’ont pas encore été réhabilitées. La Tour Bretagne est achevée depuis un an.
Le paysage est alors hérissé de grues et de cheminées, mais dix petites années plus tard, au mitan des années 1980, le territoire nantais compte plusieurs dizaines d’hectares de parcelles industrielles abandonnées. Comment se projeter vers l’avenir lesté d’un tel passif? Et pourtant, l’adjoint à l’Urbanisme de la nouvelle municipalité de gauche, Jean-Claude Bonduelle, avait indéniablement cherché à anticiper les prémisses de la concurrence entre les villes tout en cherchant la conciliation avec les enjeux du local. Un milieu se constitue autour des Sociétés d’économie mixte. L’Auran, l’Agence d’urbanisme, est créée en 1978. Avec les enseignants de l’École d’architecture c’est aussi l’embellie.
Ces rapprochements occasionnent aussi quelques frictions entre des « camps » qui commencent alors tout juste à se solidifier. Ainsi, cette anecdote sur le concours de la Médiathèque (dont la construction est décidée dès 1979) qui distingue le projet de Jean-François Salmon, proche du PS, et Maurice Ferré, architecte départemental à la carrière déjà fort honorable, alors que plusieurs collègues de l’École d’architecture avaient pour leur part rêvé de cette occasion pour mettre en oeuvre enfin un atelier public d’architecture rapprochant l’enseignement et la profession. Voici ce qu’en disait le lauréat, Salmon, vingt-cinq ans plus tard: « Tous les acteurs ont pu traduire et inscrire dans cette médiathèque un tas de réminiscences nantaises telles qu’ils les ressentaient à l’époque. C’est une architecture mémoire et palimpseste même si elle n’a pas la radicalité d’une oeuvre majeure. La commande précise était texto bâtiment destiné au développement de la lecture publique. C’est très clair: on se sert du bâtiment pour faire fonctionner la ville à cet endroit-là et on cherche à faire entrer le passant dans le bâtiment, même s’il doit pouvoir le traverser sans s’y arrêter obligatoirement. »
Reposant sur des positions voisines (la culture pour tous, la perméabilité de l’espace public, le jeu sur la mémoire industrielle…), l’autre grand chantier du municipe, la Manufacture des tabacs, cherchera également à mettre en oeuvre les prémisses d’un rapprochement entre l’enseignement et la profession d’architecte. L’opération est confiée au service d’architecture de la Ville, alors dirigé par Georges Évano. À lui d’en coordonner les différents concours où l’on souhaite voir s’engager de jeunes équipes. Les deux bibliothèques, celle de la Manu et la médiathèque Jacques-Demy sur le quai de la Fosse, ouvrent leurs portes respectivement en 1984 et 1985. L’historien Gilles Bienvenu en a très clairement retracé les enjeux: réhabiliter plutôt que rénover, et porter un nouveau regard sur le patrimoine industriel en y instaurant la mixité, sociale et fonctionnelle. L’édifice ayant cessé ses activités en 1974, la droite avait rêvé en faire un centre d’affaires, la gauche le convertit en équipements municipaux et logements sociaux. Caricatural ? Et les fausses modénatures et les structures métalliques rouge vif ? La Manu, c’était peut-être bien le fond et la forme, après tout, l’esprit de l’époque.
L’équipe Chénard est probablement celle qui aura incarné le plus fidèlement « l’esprit d’Épinay »: le précédent maire André Morice (âgé de 77 ans lorsqu’il se représente en 1977) avait longtemps soutenu une large alliance excluant communistes et gaullistes. Alain Chénard fut alors le seul conseiller municipal à appliquer les décisions du Congrès d’Epinay: démissionner du groupe de la majorité pour animer l’union du PS et du PCF. « Nous avions un programme audacieux qui voulait changer la ville, c’était son intitulé », se souvenait dans Place Publique le vainqueur de 1977. Il souhaitait, disait-il, une ville « plutôt de type alémanique, plus soft, plus verte ». Contourner plutôt que pénétrer : visionnaire, Chénard le fut certainement en posant avec détermination les jalons d’une rupture avec l’automobile, mais un visionnaire à double détente puisqu’il lança le chantier du périphérique en même temps, ou à peu de choses près, que celui du tramway.
L’élan était partagé: Changer la vie, changer la ville. C’était aussi le titre d’un livre paru un an plus tôt sous la plume du géographe Michel Phlipponeau, premier adjoint (chargé de l’urbanisme pour les douze années suivantes) du tout jeune Edmond Hervé, le vainqueur de 77 à Rennes. « Changeons Rennes ensemble », c’était le slogan de la campagne.
En 1977, les tours siamoises des Horizons de Georges Maillols, l’architecte du maire Henri Fréville (avec Louis Arretche), dominaient depuis sept ans le centre-ville. Sauf événement majeur, elle marquent pour longtemps son point culminant. Si les principes de la maîtrise foncière municipale étaient déjà posés, ils vont se transformer progressivement en une politique concertée de recyclage du foncier – à l’intérieur de la rocade. Les deux campus structuraient déjà la ville, Beaulieu et Villejean-la-rouge, Citroën aussi, Canon et Mitsubishi plus tard, et toute la politique d’Edmond Hervé va consister à faire fructifier ce pécule de départ en pariant d’abord sur l’informatique et les télécoms, plus tard sur l’agroalimentaire, tout en s’inspirant des politiques urbaines innovantes menées ailleurs. La ville a déjà tout d’une grande. Rennes Atalante sera bientôt citée un peu partout en exemple.
L’opération du Colombier sera achevée, mais on s’arrêtera là, pas de villes nouvelles au nord-est et au sudouest de l’agglomération. On ne touchera pas à la place des Lices (enfin, bien moins que prévu). En 1981, la mairie achète et restaure la chapelle Saint-Yves qui abrite désormais l’office du tourisme. L’année suivante, les piétons remplacent les voitures sur la place de la Mairie. Suscitant un joli tollé, le plateau piétonnier achève sa première phase de croissance. Par la suite, le centre basculera progressivement vers le sud: en 1982, aux bons soins du trio d’architectes BNR3, une cité judiciaire atterrit dans le quartier de l’Arsenal. Au début personne ne comprend très bien, et puis on s’y est fait. Rennes est sage et volontaire. Elle vit depuis longtemps sous le régime de la communauté, urbaine. Pour le VAL, l’histoire sera un peu plus houleuse, mais la mutation de Rennes se joue à partir de 1977 sous une forme de consensus dominant, et très vite avec l’appui des forces vives, comme on dit.
En revanche, dans une ville de Saint-Nazaire fraîchement reconstruite, en ce lendemain des élections de 1977, le politique s’inscrit dans une continuité un peu assoupie avec le second mandat du socialiste Étienne Caux. La question du logement (temporairement) résolue, on s’attaque aux équipements qui manquent encore. Pas encore de débats sur la modernité, l’heure est toujours à l’angle droit. La nouvelle Maison du peuple déploie dès 1978 sa géométrie austère face au glacis la séparant de la Base sous-marine, silhouette devenue fonctionnellement obsolète, exonérée de son but guerrier par un trafic de phosphates qui la tient animée pratiquement depuis la Libération. Après avoir résisté à tous les bombardements, pensez donc avec ses 4 mètres d’épaisseurs de béton, son toit n’a toujours rien d’un belvédère. Ne s’y trouvent pour l’heure que deux lourdes grues qui déchargent les cargaisons d’engrais. La Base, tout le monde la voit, personne ne la regarde.
Et Saint-Nazaire d’achever sa Reconstruction sans s’être encore dotée d’un projet alternatif qui n’émergera qu’une dizaine d’années plus tard avec la saga Ville-port. Il n’empêche, en 1978, Étienne Caux est pourtant lyrique en ce jour de Fête du travail et d’inauguration (partielle) de « cette Maison du Peuple tant attendue », raconte L’Éclair le lendemain. Enfin, « des locaux modernes, spacieux et fonctionnels » conçus par les architectes Louis Baizeau et Henri Demur, tous deux anciens adjoints de Noël Lemaresquier, l’architecte en chef de la Reconstruction. C’est aussi cette année-là que s’en va Lemaresquier. Il était là depuis 1943.
Avec cette nouvelle Maison, les syndicats pourront enfin quitter leurs baraquements de la place Marceau. En somme, le voilà tiré, « le trait d’union entre les hommes d’hier qui ont vécu les heures fortes et parfois tragiques du mouvement ouvrier et ceux d’aujourd’hui qui travaillent à un monde meilleur ». Un étage pour chaque organisation syndicale, et seule ombre à ce beau discours oecuménique, un ascenseur pour chaque union locale. Depuis, la Maison du peuple a été (en grande) partie détruite. Pas la Base. Dans une ville qui aura longtemps rêvé secrètement d’Amérique, cette Maison aura incarné pendant une trentaine d’années le rêve brejnévien d’une coexistence pacifique.
Alors qu’elle est en passe de se trouver en cet automne 2011 définitivement « paysagée » sous le crayon bizarrement néo-classique d’Alexandre Chemetoff, celui-là même qui conduisit dix ans durant le projet de l’Île de Nantes, la place Napoléon est alors au coeur des conversations et des enjeux, locaux et même nationaux, en ce printemps 1977. Un concours vient de s’y tenir, en 1975, et il a consacré un peu tous ceux qui incarnent alors le printemps de l’architecture française. Modernisation et changement. Immobile à grands pas, la Vendée explose et étouffe en même temps. Au terme des années 68, La Roche-sur-Yon s’ennuie. Le député-maire organise donc un concours d’architecture et d’urbanisme, concours d’idées ouvert pour réfléchir encore une fois sur son serpent de mer, bref son vide central identitaire, la place Napoléon.
Début 1976, dans un texte intitulé symboliquement Vitaliser la ville par le coeur, pour situer les enjeux du concours, le maire Paul Caillaud en passait par une double lecture, celle de la vue d’avion et celle du piéton: place centrale, « place promontoire », « point crucial des quatre routes principales qui, en desservant les quatre points cardinaux font de ce lieu beaucoup plus la place de toute la Vendée que de la seule cité », alors qu’« au ras du sol s’étale en revanche une ville au premier regard insipide, morne et froide ». Le texte du député-maire s’articule autour de deux termes: humaniser et redonner vie. Sur la foi du projet lauréat (puis reformulé) du Groupe d’architecture et d’urbanisme, La Roche-sur-Yon s’engage alors au sein de l’opération plus vaste dite des « Villes moyennes », placée sous l’égide du « retour à la ville » et patronnée par le ministère de l’Aménagement du Territoire.
Quelques mois plus tôt, l’architecte Henri Ciriani s’en félicitait : « Eh oui ! L’Architecture urbaine a été primée à La Roche. (...) pour une fois ce n’est pas le programme qui a gagné, ni son miroir dessiné, ni l’illusion du frottement des « gens animés » par les feutres rouges des urbanologues, ni l’accumulation de meubles urbains capables de tout « faire faire », ni une verdure dans le rôle de pansement médical de l’urbain, ni surtout pas une technologie proliférante à laquelle la ville doit s’adapter ». Roland Castro, le lauréat, disait avoir « volontairement » proposé une architecture « fortement connotée 19e siècle, siècle des avenues, des passages couverts, des places, des boulevards ». Le tout dans une ville qui porte « la marque de sa naissance historique, ville du pouvoir central, ville de caserne, mirador installé en Vendée par Napoléon ». Son ami Antoine Grumbach, dont le projet fut publié à maintes reprises, s’était demandé pour sa part comment désarmer une place d’armes, avec à la clé « le rachat de la faute originelle », disait-il, d’une ville militaire vouée à la répression du soulèvement.
Au fond, cette architecture urbaine, c’était peut-être bien plutôt le projet (remarqué) des frères Goldstein : « exacerber la morphologie de la ville, et considérer les données du programme comme des résidus ». Résultat : « révéler chacun des constituants » (la statue, le kiosque et un parking), les mettre en valeur sobrement et marquer par des croix « la présence d’une absence, celle des quatre îlots [ou plutôt blocs, mais à l’époque tout est îlot] non bâtis ». Pour finir, c’est à peu de choses près le principe du réaménagement de 1982, très minimal, communément désigné sous l’appellation « projet Auxiette », du nom du nouveau maire élu en 1977: une trame carrée délimitée par des blocs de pierre claire reprenant plus ou moins les principes de la grille du plan fondateur de Cormier, ingénieur des Ponts, un remplissage de pavés autobloquants ocres et trois mignardises à chacun des angles, ponctuant les trois coins vides pour faire écho au kiosque situé face à la Mairie: une roseraie, un labyrinthe végétal et une fontaine.
Trop ambitieux (et négligeant ostensiblement la campagne électorale), Paul Caillaud, le notable éclairé qui avait intitulé sa liste « pour le développement économique et la qualité de la vie », fut emporté par la vague rose des municipales du 13 mars 1977. Battu de peu, 9 891 voix contre 9 153, mais battu par la « Liste de la Gauche unie » . La périphérie a beaucoup voté et les bureaux du centre se sont plutôt abstenus. Le jeune (36 ans) censeur du lycée Pierre Mendès-France exilé à la périphérie, Jacques Auxiette, prof de maths aujourd’hui président du Conseil régional depuis le printemps 2004, s’installe pour plus de vingt-cinq ans et cinq mandats. L’un des enjeux de la campagne tourna bien entendu autour de la Place. La Place… Surtout, ne rien faire, urgent d’attendre. Un simple petit sondage lancé au doigt mouillé le 9 février 1974 par Ouest-France ne laissait déjà guère de doutes sur l’issue de toute cette énergie déployée: à la question « Faut-il construire sur la place Napoléon? », 1059 non, 94 oui !
À Brest aussi, on assiste à la victoire plutôt inattendue, dès le premier tour, d’une gauche tripartite, PS, PC et UDB, conduite par Francis Le Blé. La figure de Georges Lombard s’efface derrière la volonté de la nouvelle équipe d’instaurer, époque oblige, des procédures démocratiques pour faire une ville pour tous. Méfiante face à l’État et peut-être plus encore face à ses services dont la loyauté ne lui paraît pas acquise, elle préfère tisser des liens durables avec l’université et l’Institut de géoarchitecture de Daniel Le Couédic. À Brest aussi, on est alors (et pour un moment) à la recherche d’un centre convivial à l’ombre du vaisseau amiral de l’hôtel de ville. Au milieu des années 1960, on a autoritairement opté, avec l’onction de la Datar, pour un Brest sur le plateau du Bouguen. Symboliquement, les nouveaux élus renonceront à la troisième phase de la ZUP. Très vite, des querelles éclatent cependant, réfractant des enjeux nationaux et privant les colistiers communistes de leurs délégations. Émerge alors le premier adjoint Pierre Maille, professeur de physique en classes préparatoires qui succédera à Francis Le Blé, décédé en 1982. Maille, un méridional qui percevait Brest comme une forme d’étrangeté, curieuse plutôt qu’inquiétante étrangeté.
Un concours d’idées sort des limbes, ouvert comme à La Roche-sur-Yon et portant là aussi sur le coeur de la ville: au-delà de la place de la mairie, la place de la Liberté, il s’agissait de réconcilier Siam et Jaurès, les deux rues commerçantes brestoises. Chaque ville a son serpent de mer, toujours au centre, on y revient toujours. La rue de Siam détruite à jamais mais pour toujours chantée par les poètes, de Mac Orlan à Christophe Miossec, et la rue Jean-Jaurès, si rectiligne qu’elle semble rejoindre les confins la Bretagne. Siam et Jaurès, comme une manifestation de la « schizophrénie des Brestois », pour reprendre les mots de Daniel Le Couédic, « faite d’une passion pour leur ville systématiquement accompagnée de son dénigrement » . Ce dernier contribue alors avec son Institut à animer la concertation préalable au cours du printemps 1980: performances, vidéos, chapiteaux, débats… Jugé à la fin de l’année et s’inspirant des leçons de Bologne, le laboratoire italien de la démocratie participative, le concours permet aux projets des architectes, savamment dessinés, de cohabiter avec ceux, plus littéraires, des comités de quartiers ou de simples Brestois. On voit, sur la place de la Liberté (comme sur la place Napoléon à La Roche-sur-Yon), se déployer sous l’imposante mairie autant de jardins à la française que de forêts vierges.
Un projet s’en détache, le New York’s sister des Nantais Yves Steff et Maxime Giraud-Mangin tirant parti de la trame orthogonale de la reconstruction pour en libérer l’énergie et la hérisser de tours. Les auteurs venaient tout juste de lire le manifeste de Rem Koolhaas, New York Délire. La presse baptisera le projet Manhattan-sur-Penfeld: il reprend la trame orthogonale de l’architecte de la Reconstruction Jean-Baptiste Mathon, elle a montré ses vertus dans l’Ancien comme dans le Nouveau monde, en Grèce et à New York. L’Amérique, mais tendons-lui les bras!
Vingt ans plus tard, au tout début des années 2000, la même équipe, AUP (dont Yves Steff et Jean Lemoine), sera appelée pour élaborer la ZPPAUP de Brest qui s’avérera particulièrement respectueuse des édifices de la reconstruction, de leur gabarit surtout et de l’unité qu’ils installaient. Les tours sont loin, à la périphérie, mais elles avaient entre-temps stimulé les imaginaires. Les enjeux avaient bougé, et cette équipe avait bien distingué deux conjonctures. En septembre 2011, trente ans plus tard, le Nantais Yves Steff voyait les choses avec la perspicacité que confère le recul temporel: « loin d’un revirement, ces deux projets s’inscrivaient dans la même quête d’une réhabilitation d’une ville injustement décriée, mais les moyens pour y parvenir avaient changé, ce qui témoigne de l’évolution des doctrines ».
Passée l’euphorie de mai 1981 où l’enthousiasme fut à son comble, conduisant à reporter sine die des projets apparaissant soudain trop étriqués, à Brest ou à Nantes, la sanction électorale fut identique le 6mars 1983: la défaite de quelques voix. À Nantes, une désaffection du vote des quartiers populaires conjuguée à un baroud d’honneur de la vieille maison SFIO avec les 4,5 % d’André Routier-Preuvost à la tête la liste « Nantes d’abord », et voilà balayée dès le premier tour l’une des expériences originales issues des municipales roses. Le tramway est sauvé, contrats obligent, mais pas ceux qui l’avaient décidé. À Brest, on a tout juste eu le temps d’organiser en janvier sous l’intitulé « Villes reconstruites, villes à construire », un colloque qui pour une fois fera date, initiant un retournement des sensibilités. Comme à Lorient ou à Saint-Nazaire, il s’agissait de faire comprendre les enjeux de la Reconstruction et son urgence. Pour la statistique, tout allait bien, la ville était reconstruite ; pour l’imaginaire, il en allait tout autrement.
Destruction – reconstruction: c’est à l’occasion du débat de clôture que l’urbaniste belge aujourd’hui en charge du projet de l’Île de Nantes, Marcel Smets, parla d’une continuité accélérée de ces villes reconstruites, les percevant comme la « phase accélérée d’une continuité historique » . Au fond, sur l’Île également, ce qui s’est élevé depuis dix ans jusqu’à la forme, et qui s’est sauvé dans et par la forme, n’est plus aussi qu’une forme. Et puis un sort commun pour Brest et Nantes entre deux alternances, entre 1983 et 1989, une dualité politique centre - périphérie: en cale sèche, pas un seul projet urbain, même modeste, qui ne soit l’objet de conflits et de tiraillements entre la Communauté urbaine et la mairie à Brest et entre Nantes et sa périphérie.
La défaite électorale, ce qu’il en coûte de mettre une ville en mouvement? Mais pour se perpétuer, la vigueur de ces luttes urbaines et des groupes qui les soutenaient avait besoin d’un antagonisme constant, et ce sont peutêtre bien au fond ces municipales de 1977 qui, d’une certaine manière, sonnèrent le glas de la scène alternative. Ce ne furent pas les idées ni les projets qui manquèrent, plutôt la manière de les mettre en oeuvre. La bergerie de la Blaquière, construite sans permis sur le plateau du Larzac et financée par le refus de l’impôt, ça ne vous rappelle rien du côté de Notre-Dame des Landes ?
Ailleurs (à Paris), ce sont des préfets qui ont fait la ville, ou du moins cherché à la faire, d’Haussmann à Claude Guéant en passant par Paul Delouvrier. Des hommes d’ordre et de mise en ordre appréciant les grandes perspectives ouvertes et dégagées. À Rennes et Nantes après 1977, ce sont plutôt des universitaires qui auront mis en musique la construction de la ville. Si l’on voulait tresser un parallèle, le rapport aux questions urbaines semble s’être aujourd’hui modifié à l’image du rapport plus général qu’une société entretient avec ses intellectuels. Il n’y a pas si longtemps, à l’avant-garde, ces derniers étaient appelés à dire le sens, d’une société, de ses évolutions, ses projets et ses mutations (urbaines). Devenus des médiateurs, à l’image d’un Didier Fusillier à Lille ou d’un Jean Blaise à Nantes, les nouveaux intellectuels doivent encore faire un peu tout cela mais en y rajoutant du « festif » dans un cadre collectif susceptible de catalyser et dynamiser les énergies. Pour qu’enfin s’épanouissent cent « quartiers de la création »? Nous serons entre-temps passés de l’État-éducateur à l’État-séducteur, et les grandes villes en particulier auront allègrement emboîté, au fil de leurs projets, le pas de ce mouvement plus général.








